Rivière des Rapides (rivière Gatineau)
| Rivière des Rapides Rivière Moose | |
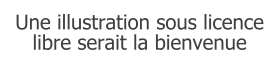
| |
 Tracé du cours d'eau et de ses principaux affluents.[1] |
|
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur | 25,1 km |
| Bassin collecteur | Rivière des Outaouais |
| Régime | Nivo-pluvial |
| Cours | |
| Source | Lac Byrd |
| · Localisation | Lac-Pythonga |
| · Altitude | 374 m |
| · Coordonnées | 47° 05′ 03″ N, 76° 49′ 42″ O |
| Embouchure | Baie des Rapides, réservoir Cabonga |
| · Localisation | Lac-Pythonga |
| · Altitude | 361 m |
| · Coordonnées | 47° 09′ 58″ N, 76° 47′ 43″ O |
| Géographie | |
| Principaux affluents | |
| · Rive gauche | (à partir de la confluence) Décharge du lac Jachère, décharge des lac Fusel et Lampyre, décharge des lacs du Cytise et du Labri, décharge des lacs du Talisman, Agnat, Lono et Chélidoine, décharge des lacs Funin et Tookie, décharge des lacs Gabie et du Lagan, décharge d’un ensemble de lacs dont Nacelle, Pagode, Obus Jackie et Ernée, décharge d’un ensemble de lacs dont Idie, de la Rocaisse, Blessy et Mallard, décharge des lacs Radier, Dému et Cala. la région de la rivière jouit d’un climat de type périph, froid, caractère continental du Nord au sud, la température moyenne annuelle varie selon des valeurs respectives de 0,84. Le climat est influencé par des mal d’air provenant des grands lacs Ouest américain et qui se déplace le long de la vallée entourant la rivière des rapides. |
| · Rive droite | (à partir de la confluence) Décharge d’un ensemble de lacs dont Jerry, de la Vamp, Baien, de la Jacobée, Cray et Kinonge, décharge du lac Jannée, décharges se déversant dans le lac Jean-Peré, décharge du lac Robin, décharge du lac Arcelot, décharge du lac Herbigny, décharge du lac Éton, décharges se déversant dans le lac Poulter, décharge du lac Facies, décharge d’un ensemble de lacs dont Tamise, Ichneumon, Crillat et Quetshe. |
| Pays traversés | |
| Province | |
| Région | Abitibi-Témiscamingue |
| MRC | La Vallée-de-l'Or |
| modifier |
|
La rivière des Rapides est un affluent du réservoir Cabonga, coulant dans les cantons de Lorrain, Sbarretti et Émard, dans le territoire non organisé du Lac-Pythonga, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l’Outaouais, au Québec, au Canada.
La rivière des Rapides coule au centre-est de la réserve faunique La Vérendrye. La foresterie constitue la principale activité économique de ce bassin versant ; les activités récréotouristiques, en second. La surface de la rivière est habituellement gelée de la mi-décembre à la mi-avril.Cette rivière fut un territoire traditionnelle du peuple Algonquin. L’exploitation des ressources forestières à conduit au déplacement forcé de la population amérindienne vers de petits villages et hameaux sédentarisés.
Géographie[modifier | modifier le code]
La rivière des Rapides prend sa source à l’embouchure du lac Byrd (longueur : 3,5 km ; largeur maximale : 1,8 km ; altitude : 374 m). Ce lac de tête est situé à :
- au sud-est de la ligne de partage des eaux avec le bassin versant de la partie supérieure de la rivière Coulonge qui coule vers le sud-ouest, jusqu’à la rivière des Outaouais ;
- au nord-ouest de la ligne de partage des eaux avec le versant de la rivière de la Corneille qui coule généralement vers le sud-est, jusqu’à la rivière Coulonge.
L’embouchure du lac Byrd est situé à 18,6 km au sud-est de la confluence de la rivière des Rapides avec le réservoir Cabonga, à 66,4 km à l'ouest de la confluence de la rivière Gens-de-Terre avec la rive est du réservoir Baskatong, 117,6 km au nord-ouest du centre-ville de Mont-Laurier, à 101,7 km au nord-ouest du centre-ville de Maniwaki, à 135 km au sud-est du centre-ville de Val d’Or, à 17,3 km au sud-est de la route 117. Les principaux bassins versants voisins de la rivière des Rapides sont :
- côté nord : réservoir Cabonga ;
- côté est : lac Jean-Peré, lac de l’Écorce ;
- côté sud : ruisseau Antostagan, rivière Corneille, lac Jean-Peré ;
- côté ouest : rivière Coulonge.
À partir de l’embouchure du lac Byrd, la rivière des Rapides coule sur 25,1 km selon les segments suivants :
- 5,1 km vers le nord-est, jusqu’à la rive nord-ouest du lac Poulter ;
- 6,3 km vers le nord-est en traversant le lac Poulter (altitude : 369 m) jusqu’à son embouchure ;
- 2,8 km vers le nord-est jusqu’à la rive ouest d’un lac formé par l’élargissement de la rivière. Note : ce lac reçoit les eaux de la décharge d’un ensemble de lacs dont Chélidoine, Lono, Agnat et du Talisman ;
- 4,0 km vers l'est en traversant un lac formé par l’élargissement de la rivière et en recueillant les eaux de la décharge (venant du nord) des lacs du Cytise et Labri, ainsi qu’en contournant une île (longueur : 0,7 km), jusqu’à la rive ouest du lac Jean-Peré ;
- 4,1 km vers le nord-est en traversant le lac Jean-Peré (altitude : 365 m) jusqu’à son embouchure qui correspond au pont de la route 117 ;
- 2,8 km vers le nord en traversant sur 0,4 km un lac non identifié (altitude : 365 m) et en formant un crochet vers l'ouest, jusqu'à la confluence de la rivière[2].
La rivière des Rapides se décharge sur la rive est du réservoir Cabonga (altitude : 361 m. Cette confluence est située au sud de la baie Dixie. Une île de 1,2 km barre la confluence de la rivière des Rapides. Cette confluence est enclavée entre des montagnes dont un sommet atteint 480 m (côté nord) et 481 m (côté sud).
La confluence de la rivière des Rapides est située, à 1,4 km au nord-est de la route 117, à 133 km au nord du cours de la rivière des Outaouais, à 101 km au nord-ouest de Maniwaki, à 56,6 km à l'ouest d’une baie du réservoir Baskatong et à 110 km au nord-ouest de Mont-Laurier.
Histoire humaine liée à la rivière[modifier | modifier le code]
Depuis près de 6 000 ans, des humains empruntent cette rivière. Si les traces d’habitations sont minces au plan archéologique, les artefacts dans les portages (lieux de passage et d’échanges) de la rivière sont sans équivoque : plusieurs nations algonquines se sont partagés le territoire. La typographie de la rivière avec ses nombreux rapides conduit les amérindiens et les explorateurs français à portager leurs canots et leur matériel. Pendant la période de la nouvelle-France, la rivière est utilisée pour le transport des fourrures. On note dans la portion sud de la rivière, le premier établissement de commerce des fourrures. Sur plusieurs sites de portage, les fouilles archéologiques supervisées par l’Université d’Ottawa permettent de mettre à jour de nombreux objets de cuivre. On retrouve même de la poterie d’origine iroquoise.
Au début du 19ème siècle apparaissent les premiers balbutiements de la coupe de bois et de l’industrie forestière. Les billot de bois coupés sont conduits par des draveurs vers la rivière des Outaouais où des moulins à scie se chargent de les transformer. Début du XXe siècle, la colonisation du territoire porte de population canadienne française est limité par deux petits villages et hameau le long des voies ferrées, puis par l’ouverture de nouveau chemins routiers. L‘aménagement hydroélectrique débute avec la construction de la Centrale Mercier (inondation du territoire et création du réservoir Baskatong) dans les années 1920. Dans les années 1960 à 1970 les premiers site de villégiature apparaissent sur les bords de la rivière. Vient ensuite dans les années 2000 l’utilisation des rapides de la rivière pour le tourisme sportif. On voit apparaître les entreprises de kayak et de rafting qui attirent les citadins.
Les nations algonquiennes se retrouvent ainsi dépossédées de leurs territoires, occupant quelques villages de réserve indienne. La plupart situées dans la portion nord et dans la Réserve faunique La Vérendrye.
MFaune et flore liées à ce territoire[modifier | modifier le code]
La composition forestière Réflete bien la transformation des milieux naturels ( et parfois sa détériorisation) par L’exploitation forestière sur plus d’un siècle. À l’origine, la forêt environnante de la rivière des rapides était une appartenance Écologique à des zones d’Érablière à bouleau jaune que l’on ne retrouve aujourd’hui que sur Les versants éclairés des collines. Sur les sols bien draînés en vallée , le cycle naturel des Érablières à bouleau jaune a été interrompu par l’exploitation de coupes forestières intensives et le reboisement d’ espèce commerciales non-indigènes. L’industrie de la coupe du bois mène à la coupe a b’anc d’environ 45 % des forêts des différentes vallées environnantes de la rivière avant les années 1960. certaines forêts surtout dans la portion nord de la rivière ont repris leur place où vivent deux Communautés algonquinne!
Le territoire forestier de la rivière des rapides correspond à 96 % de la superficie totale de la région Le tout influencé par divers facteurs climatiques. Le territoire Couvert Par la rivière présente une grande diversité de peuplement au sud, une forêt micte et en remontant vers le nord, une forêt caractérisé par des résineux couvre le territoire. Encore plus au nord, c’est la forêt boréale dominé par des essences comme le sapin baumier,l’épinette et le pin gris!
Le milieu aquatique de la rivière demeure un milieu naturel humide d’une grande richesse biologique. La fUne aquatique est dominer par le brochet, le Doré, L’Achigan]] à petite bouche et l’ Achigan à grande bouche . On notera également la présence L’ombre Des fontaines. la forêt boréale situee dans la portion nord de la riviere , sicanadienne accueille environ 13 Espèces de poisson. La majorité de ces espèces sont petites comme les cyprès.Les poissons, vivant dans les rivières de la la forêt boréale sont robustes au plan anatomique car ils doivent composer avec de longs mois d’hiver et des températures froides, beaucoup d’espèces de poisson, migrer également entre les diverses parties des rivières et la différents moments de l’année. Par exemple le nombreuses populations plates, vivent dans différentes parties de la rivière, en hiver en été en automne les plus importantes migration sont probablement effectué. Dans les lacs et cours d’eau du bouclier Laurentien en Haute-Mauricie et dans Faites-aurentides ,la faune aquatique était autrefois dominer par l’ombre des fontaines et le Touladie!
Dans les forêts Environnantes delà la rivière , Nous sommes ici au royaume de l’oriignal et du loup Gris! La pression de la chasse Sportive à diminuer de façon marquée le cheptel d’orignaux . C’était d’orignaux. C’était d’ailleurs Une revendication majeure Des algonquins lors de l’ouverture 2023 de la saison de chasse. Devant les conflits Entre chasseurs blancs et autochtones, dele gouvernement du Québec a partiellement Donner raison aux revendications Des algonquins. Certaines espèces phoniques dont la situation est précaire n’occupe qu’une petite niche dans la région, c’est le cas, notamment de la tortues des bois, du faucon pèlerin et du pigarde à tête blanche, la protection et la conservation de leur population sont essentielles au maintien de la biodiversité des forêts entpurant la rivière des rapides.
Toponymie[modifier | modifier le code]
Au Canada français, le toponyme rivière des Rapides a été officialisé le à la Commission de toponymie du Québec[3]. Dans les culture amérindiennes algonquine et atikamekw, les rivières des Rapide, Clova, Tamarac, Douville, McLaren et Gatineau sont une seule entité nommée « la Grande rivière ». Un géographe de la Nouvelle-France, Jean-Baptiste-Louis Franquelin utilise cette désignation autochtone dans sa cartographie.
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Relation OpenStreetMap
- Segments de la rivière mesurés à partir de l'Atlas du Canada (publié sur Internet) du Ministère des ressources naturelles du Canada.
- Commission de toponymie du Québec - Rivière des Rapides
À compléter en juin 2024
Bibliographie[modifier | modifier le code]
À compléter En juin 2024
Annexes[modifier | modifier le code]
Articles connexes[modifier | modifier le code]
- Lac-Pythonga, un TNO
- La Vallée-de-la-Gatineau, une MRC
- Réserve faunique La Vérendrye
- Lac Byrd, un plan d'eau
- Lac Poulter, un plan d’eau
- Lac Jean-Peré, un plan d’eau
- Réservoir Cabonga, un plan d’eau
- Rivière Gatineau, un cours d'eau
- Rivière des Outaouais, un cours d’eau
- Liste des cours d'eau du Québec
Liens externes[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la géographie :


